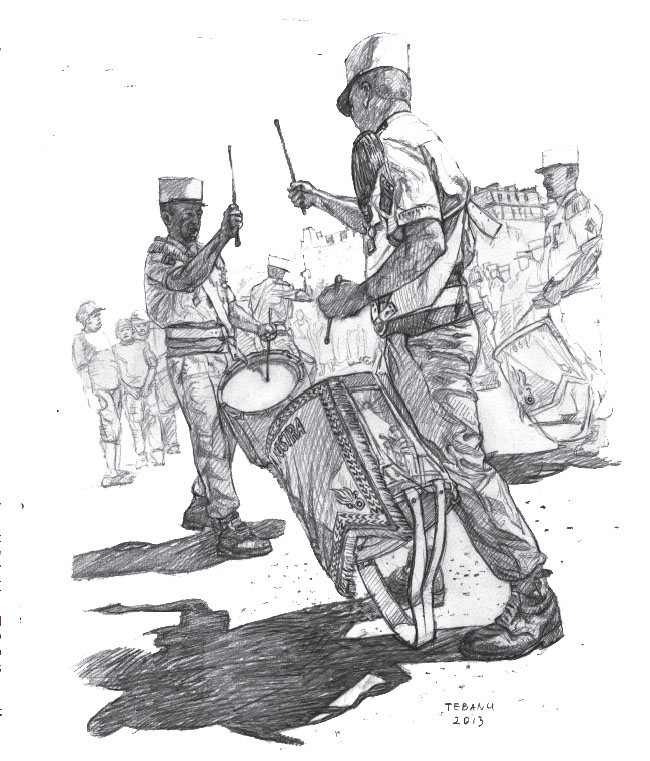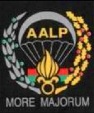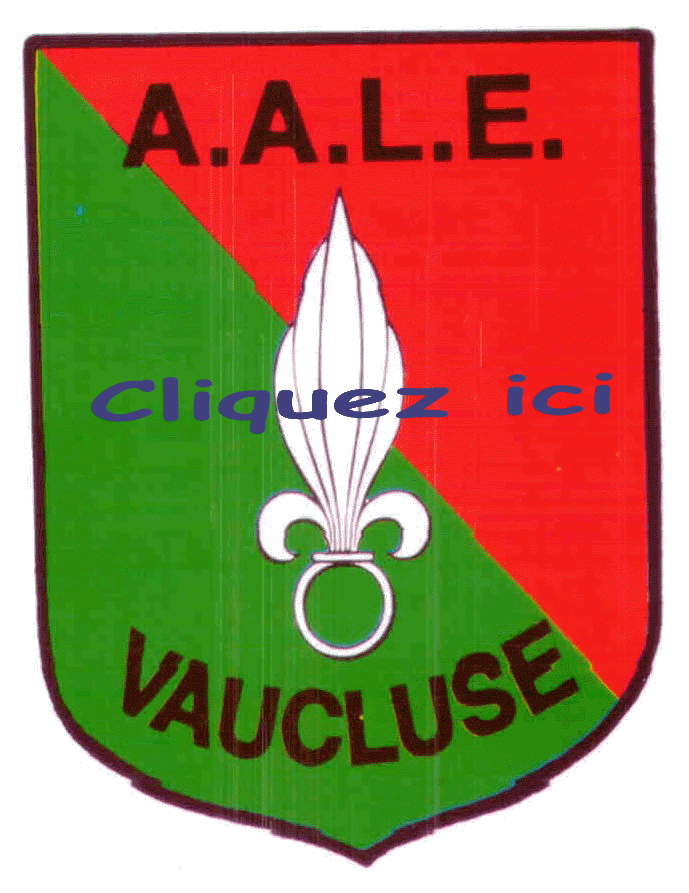Messieurs les ministres, Amiral, Mesdames et Messieurs les Officiers, officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins,
C'est une vraie fierté pour moi d'être aujourd'hui en mer avec vous, sur le porte-avions Charles de Gaulle, le navire amiral de la flotte française de combat. Je suis très heureux de saluer ici des femmes et des hommes, qui, tous unis au service de la France, accomplissent les missions essentielles à notre indépendance et à notre sécurité. Je suis déjà venu à bord de votre porte-avions, mais c'est la première fois que j'embarque en tant que chef des armées.
J'ai tenu à venir vous rencontrer pour vous dire d'abord mon estime et ma confiance. La France et les Français peuvent être fiers de vous, fiers de vos compétences et fiers des moyens tout à fait exceptionnels qui sont mobilisés ici au service de nos engagements internationaux et de notre sécurité. Ce bâtiment et l'ensemble du groupe aéronaval, avec leurs technologies de pointe, avec ces fleurons de l'aéronautique française que sont les Rafale, symbolisent tout ce que la France est capable de maîtriser et de développer comme savoirs les plus avancés, dans le cadre d'une autonomie stratégique dont disposent aujourd'hui très peu de nations. Vous incarnez également la détermination de la France à conserver la maîtrise de son destin dans un monde de plus en plus complexe, dans un monde plus instable, dans un monde au final plus dangereux.
La France est, avec les Etats-Unis, l'un des deux seuls pays au monde capables de réaliser une telle prouesse : concevoir et construire un porte-avions nucléaire ainsi que son groupe aérien embarqué. Nous faisons donc partie d'un club très fermé ; je n'ignore nullement qu'il a fallu des années d'apprentissage, de persévérance pour maîtriser de tels savoir-faire techniques, industriels et opérationnels. Mon devoir, c'est de les conserver.
Vous êtes aujourd'hui les détenteurs de ces savoir-faire hors du commun. Et c'est là une fierté plus grande encore, de voir nos armées maîtriser et diriger les technologies d'une telle précision. Je vous remercie parce que j'ai été très impressionné par la qualité des démonstrations qui m'ont été présentées et par la capacité de coordination exceptionnelle que tout ceci révèle. Sur un porte-avions, l'erreur ne pardonne pas et il faut à chaque instant être au rendez-vous de l'excellence, du professionnalisme le plus exigeant. Le métier de pilote est particulièrement exposé, et je m'en voudrais de ne pas évoquer la mémoire du capitaine de frégate François DUFLOT. Je veux redire à sa famille toute ma solidarité.
Je salue votre dévouement, votre rigueur, votre perfectionnisme qui sont des atouts pour remplir les missions que la Nation vous confie. Je mesure le travail qu'a représenté la période d'entretien majeur que vous avez récemment connue, et la détermination avec laquelle vous avez dû vous entrainer pour revenir au meilleur niveau opérationnel. Je sais que nous pouvons compter sur vous, et nous avons besoin de vous. Que nul n'en doute, vous n'êtes pas seulement un élément du prestige de la France, vous êtes des femmes et des hommes opérationnels.
Pour qu'un ensemble tel que le Charles de Gaulle puisse fonctionner, il faut une qualité qui est au coeur de l'engagement des marins : ce que vous appelez l'esprit d'équipage. C'est un défi de savoir maintenir cet esprit sur un navire qui réunit près de 2 000 personnes. Ici, la réussite est collective ou elle n'est pas. La réussite, et parfois la vie, de tous dépend de chacun. Chacun, quelles que soient sa place et sa fonction, doit se mettre au service de tous. Vous montrez un beau visage de la France et un bel exemple.
Être soldat, être marin, c'est travailler en équipage, c'est consacrer sa vie au service de la France. Ce choix, vous l'avez fait en acceptant les contraintes de la vie embarquée, et notamment celle de ne pouvoir partager en permanence le quotidien de vos proches, Je veux vous dire ma reconnaissance et celle de la Nation. Je veux avoir une pensée pour vos familles, parce que vos familles partagent votre engagement en vous laissant le vivre.
Vous faites un métier difficile, un métier d'exception qui révèle des personnalités d'exception. Je pense notamment à l'actuel chef d'état-major des armées, l'amiral Guillaud, qui a été commandant de ce bâtiment. J'ai dit à votre commandant que cela lui donnait des perspectives !
Notre porte-avions porte un nom qui symbolise la grandeur de la France. Il porte le nom de Charles de Gaulle, celui qui refusa la défaite, qui refusa la soumission à l'ennemi, qui remit la France sur le chemin de la liberté, sur le chemin de l'honneur, qui rétablit la République et l'Etat de droit, et qui nous légua les institutions les plus stables et les plus efficaces de notre Histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que vous soyez associés à la commémoration du 70ème anniversaire de l'Appel du 18 juin. A Carlton Gardens, devant la statue du général de Gaulle, c'est à vous qu'il reviendra de lui rendre les honneurs.
Ce bâtiment symbolise une France qui assume ses responsabilités, nous sommes un grand pays, cela nous donne des droits, mais cela nous donne d'abord des devoirs. Nous devons consacrer les moyens qui nous permettent de peser sur la scène internationale comme un grand pays, nous devons conserver les capacités d'agir partout dans le monde en projetant nos forces. Sinon, nous ne serions pas un grand pays, nous ne serions plus un grand pays.
Avec le porte-avions et son escorte, la France dispose d'un instrument politique de premier plan ; le Charles de Gaulle, c'est une pièce maîtresse de notre dissuasion nucléaire. Le général de Gaulle a été le premier à avoir compris l'importance de la dissuasion nucléaire pour notre indépendance. Eh bien, la dissuasion reste pour la France un impératif absolu. La dissuasion nucléaire est pour nous l'assurance-vie de la Nation, c'est la garantie qu'un autre Etat devra bien réfléchir avant de s'en prendre à nos intérêts vitaux, sauf à s'exposer à une sanction qui serait alors hors de proportion avec les avantages recherchés.
Le porte-avions est un outil décisif pour que la France exerce les responsabilités qui lui incombent en tant qu'acteur majeur sur la scène internationale. Nous vivons, Mesdames et Messieurs, dans un monde incertain, caractérisé par la multiplication des risques, par la dissémination de la violence, un monde qui repose sur des organisations et des règles désormais obsolètes, un monde qui doit inventer celles du siècle qui s'ouvre. C'est pourquoi j'ai pris une responsabilité lourde, qui consiste à m'engager, en tant que chef de l'État, à ne pas baisser la garde en relâchant notre effort de défense. C'est la vocation première de l'État et c'est ma responsabilité en tant que chef des armées. Depuis 2007, toute mon action a eu pour objectif de construire une défense crédible, cohérente avec les menaces qui pèsent sur notre nation. Pour réaliser cette ambition, l'ensemble du ministère de la défense et des forces armées s'est mis en mouvement de façon exemplaire et je remercie Monsieur le ministre Hervé Morin, ainsi qu'Hubert Falco. Les réformes commencent à porter leurs fruits et je rends hommage à tous ceux qui y contribuent. Peu d'administrations de l'Etat peuvent se targuer d'avoir conduit à intervalles réguliers des efforts d'adaptation et de modernisation aussi conséquents. Chacun doit être conscient, dans nos forces armées comme ailleurs, que cet effort d'adaptation est indispensable. La remise en question et le changement ne peuvent plus être l'exception. Ils doivent être la règle. Il n'y a pas de place, il n'y a plus de temps, il n'y a pas d'avenir pour l'immobilisme et le report indéfini des décisions difficiles dans le monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons nous adapter, nous devons prendre les décisions au moment où on a encore une chance de pouvoir les prendre, nous ne pouvons pas subir. Le monde bouge à une vitesse stupéfiante. La France ne peut pas demeurer immobile. Et nos forces armées doivent s'adapter, et elles le font, pour rester opérationnelles.
Je sais que, parmi vous, il y a des inquiétudes sur les moyens de notre défense au moment où nous devons redoubler d'efforts pour redresser les finances de la nation. Car, évidemment, un pays trop lourdement endetté n'est plus un pays indépendant. Chacun y contribuera, mais je veux vous assurer de ma détermination : je veillerai en toutes circonstances à ce que la France et les Français soient en sécurité. C'est mon premier devoir de chef de l'Etat et de chef des armées : garantir la sécurité de la France et des Français, et cette sécurité passe par vous. Alors j'y veillerai, à l'intérieur de nos frontières comme à l'extérieur, afin que vous disposiez des capacités opérationnelles dont vous avez besoin ; la France doit tenir son rang, la France doit rester à la hauteur de ses responsabilités en Europe et dans le monde. La France, vecteur de paix.
Notre pays assume aujourd'hui pleinement ses responsabilités de grande puissance, grâce à notre participation aux structures de commandement de l'OTAN. Nous avons 10 000 femmes et hommes actuellement engagés au nom de la France dans des opérations extérieures pour préserver la paix et défendre nos valeurs. Et j'annonce que vous allez vous-mêmes allez partir en opérations avant la fin de l'année en Océan Indien et dans le Golfe persique. Cela ne peut que vous réjouir. Vous êtes engagés pour ça, pour partir, pas pour rester. Donc, l'Océan Indien et le Golfe persique.
Les missions que vous allez accomplir là-bas sont cruciales. En Afghanistan la France mène, avec ses alliés, la lutte contre la barbarie et les barbares qui menacent de faire basculer une région si importante pour les équilibres et la sécurité du monde.
Je veux saluer tous ceux qui se trouvent déployés en Afghanistan pour notre sécurité.
Il y a 3 jours, au sud de Tagab, un légionnaire a été tué par un éclat de roquette tirée par des insurgés : je m'incline avec respect devant sa mémoire, au nom de la France. Mes pensées vont à sa famille, et à ses trois camarades qui ont été blessés avec lui. Nous sommes avec eux dans l'épreuve.
Je veux que vous soyez convaincus d'une chose : à chaque fois que l'un d'entre vous ne rentre pas à la maison, je me sens personnellement responsable parce que la décision ultime de vous envoyer est prise par le chef des armées. Et je ne considère pas que mourir soit le destin d'un militaire. Je n'accorde aucun crédit à la fatalité. Chaque fois, je me remets en question moi-même devant ce cercueil ou devant cette famille. Vous avez un devoir, j'en ai un aussi. Je dois prendre des décisions difficiles. Et, croyez-bien que c'est un moment où la pression est très intense sur les épaules d'un chef de l'Etat et d'un chef des armées.
Mais la France ne peut pas renoncer à lutter contre le terrorisme et les terroristes. Ce n'est pas possible. Et nous devons aider les Afghans jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'assumer seuls leur sécurité et leur développement. Nous devons poursuivre le combat contre les Taliban et Al Qaeda. Si la France n'a connu, au cours de ces dernières années, aucune attaque terroriste, nous le devons à l'efficacité de nos forces de sécurité et de défense, nous le devons à notre détermination et à notre pugnacité ; mais la menace est là, elle est réelle et il n'est pas question de relâcher notre vigilance ou notre action.
Aujourd'hui, sur l'arc de crise qui s'étend jusqu'à l'Océan Indien se joue l'avenir de notre sécurité, de notre prospérité, la crédibilité des valeurs universelles que la France a toujours portées. Notre Nation sait qu'elle peut compter sur vous pour assurer cet avenir.
Alors en mon nom et au nom de la France, je veux vous dire aujourd'hui, à chacun d'entre vous personnellement, marins et pilotes du porte-avions Charles de Gaulle, toute ma reconnaissance et toute ma confiance. Soyez fiers de l'uniforme que vous portez, des valeurs que vous servez, du métier que vous avez choisi, de la mission que vous accomplissez. Tout le monde ne peut pas le faire. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites pour la France, fiers du drapeau et des valeurs que vous servez. Quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas à vous demander pourquoi vous avez choisi ce que vous faites, vous le savez. Vous avez beaucoup de difficultés, vous affrontez beaucoup de menaces. Mais il y a une chose dont vous ne doutez pas : la raison pour laquelle vous vous êtes engagés et ce que vous faites ici. C'est une forme de privilège ! Quel que soit votre grade, quelle que soit votre fonction, ce n'est pas rien de pouvoir se dire qu'on participe à la sécurité et à l'indépendance nationale de la cinquième grande puissance du monde. Vous êtes les dignes successeurs des grands noms que portent ce magnifique navire et, avant lui, ses deux prédécesseurs, le Foch et le Clemenceau.
Avec Hervé MORIN, avec Hubert FALCO, avec le chef d'Etat-major, l'Amiral GUILLAUD, avec mon chef d'Etat-major particulier, Benoit PUGA, je voudrais vous dire que c'est un réel plaisir d'être ici avec vous et de partager ce moment avec vous. Sachez aussi que, lorsque vous serez dans la peine, dans la douleur, je serai avec vous aussi et que je veillerai quel que soit le contexte très difficile des finances publiques, à ce que votre sécurité ne soit jamais mise en cause par un défaut d'équipement ou un défaut d'entrainement. C'est aussi ma responsabilité.
Vive la République !
Vive la France !