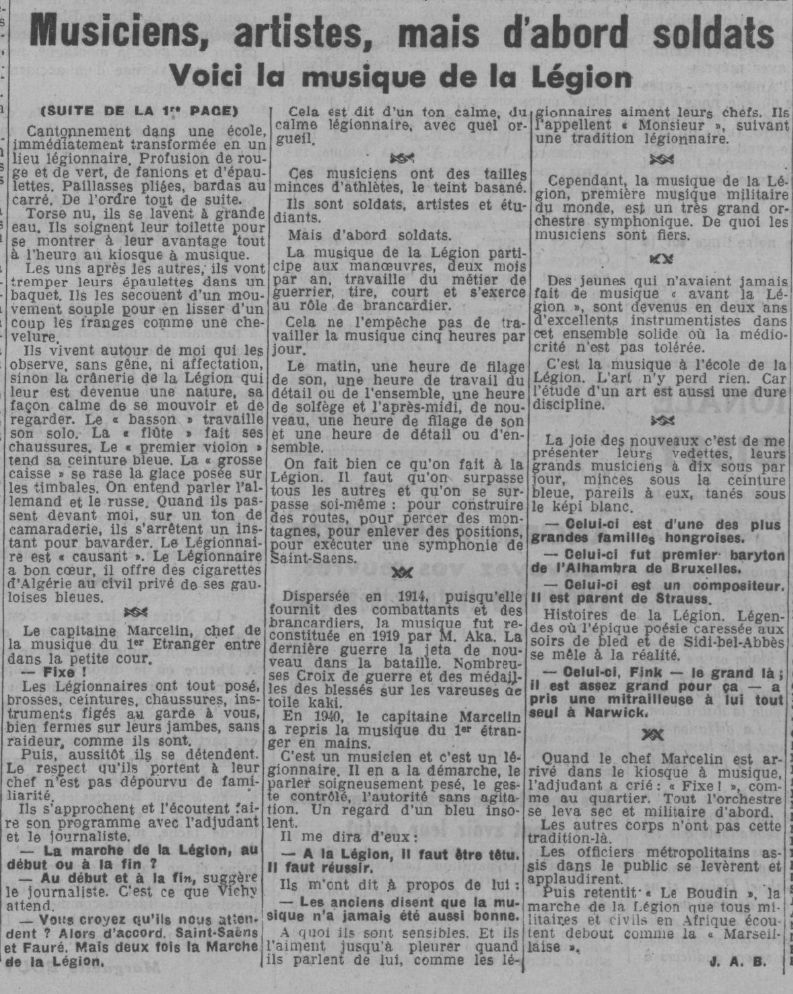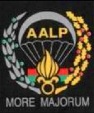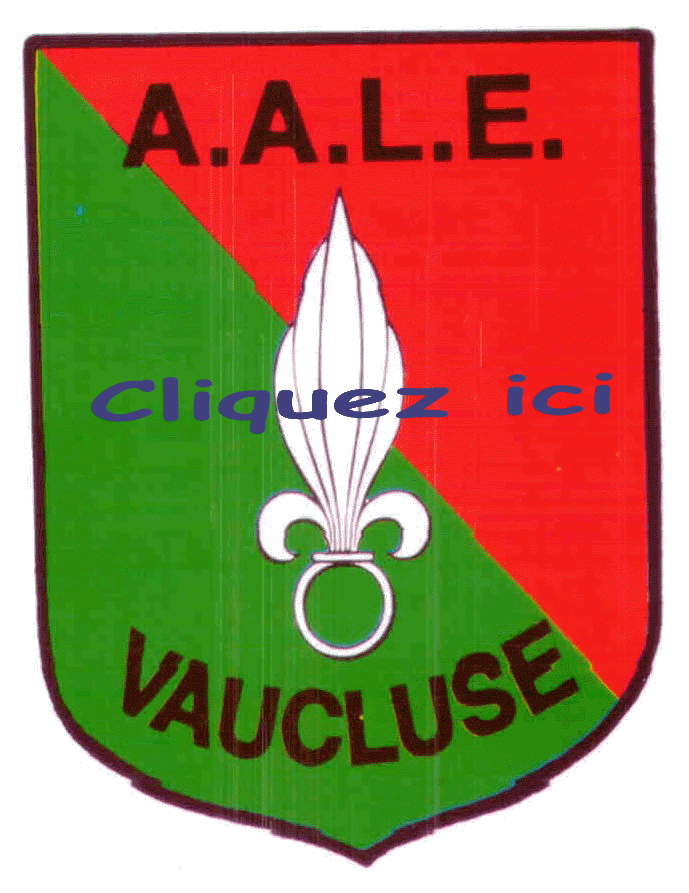1941
7 jours : grand hebdomadaire d'actualités 19411109
Le Journal 26/08/1941
Le Temps du 31 mai 1941.
RIEN N'EST PERDU
LA GUERRE. DE MAI A L'ARMISTICE, - AU 11e RÉGIMENT DE LÉGION ÉTRANGÈRE Par Georges R. MANUE
La source s’appelait Néère. Elle chantait en contre-bas du grand layon, dans un ravin aussi joli que son nom. Elle ravitaillait en eau les unités au contact, et à toute heure du jour les files de soldats, tirailleurs et légionnaires, descendaient et remontaient le raidillon, chargés comme des mulets. Ils se donnaient un peu de bon temps à la source, qui, comme le puits au centre du village, était pour notre forêt un lieu de parlotes. Chacun contait son histoire, magnifiait son unité et envisageait l'avenir. Les échos de ces conversations,
qui dominaient le murmure de l'eau, finissaient par l'emporter sur ceux des cuisines pour la richesse, la variété, l'inattendu des informations.
La nuit dernière un obus de 210 a tari la source, retournant le sol autour d'elle. Ce fut d'ailleurs un sacré bombardement, pas très long mais intense. Le P. C. du colonel a été, lui, labouré comme un champ, et le colonel a failli étouffer sous la terre dont un gros obus recouvrit son abri. A vrai dire, ce n'était pas un abri de colonel, mais une simple sape, recouverte d'une tôle métro à l'épreuve des éclats et disponible pour le moindre coup au but. Dieu merci, le 210 est tombé à côté. Une note de l'armée reproche - paraît-il - à certains commandants de régiments la distance qui sépare leur poste de commandement de leurs unités en ligne, avec lesquelles ils finissent par n'avoir que de médiocres liaisons téléphoniques. Voilà un grief qui n'atteint pas le nôtre.
Le bombardement commença au début de la nuit. L'avion allemand, que les hommes appellent le « Mouchard » parce qu'il fait matin et soir son vol de surveillance, avait tourné en rond, au-dessus du ravin, noté des amorces de travaux, fait son rapport. L'animal avait bien vu et bien signalé l'endroit. Ce fut un sacré marmitage, qui tua du monde jusque dans les abris, trop improvisés. Gros et moyens calibres, on les distinguait mal dans ce vacarme où le nombre des arrivées ne laissait pas aux détonations le temps de développer l'ampleur de leur fracas. Puis le tir devint plus court, fit un saut en arrière, et ce fut le tour des bataillons. Notre artillerie n'était pas en retard. Elle donnait tant qu'elle pouvait On finit par dormir, le casque sur le nez. L'accalmie fut soudaine, imprévue. On n'entendit que les craquements des grosses branches brisées qui tardaient à tomber, et alors s'éleva le cri des blessés. Ils étaient nombreux. Le toubib fit, dès cette nuit, grosse impression sur ses aides et brancardiers. Calme, rapide, précis. Les morts, nous les avons relevés à l'aube ; ceux, en tout cas, que personne n'avait vus tomber. Les autres étaient déjà allongés au poste de secours, leurs poches inventoriées, les mains, quand elles n'étaient point abîmées, jointes sur la poitrine. ?
Les hommes, le jour venu, inspectaient le décor avec une curieuse nuance admirative : « Du beau travail », et puis ce correctif : « Les salauds ! » Sur le layon central, alors que je montais au bataillon pour la première liaison du jour, je croisai les brancards poussés ou retenus, au gré de la route, par les musiciens dont c'est le métier - le dur métier- au feu. « De la casse ? - Pas mal dans les trois bataillons. »
Et de me citer des noms de chefs et de légionnaires. Tout ceci se faisait presque sans marquer un temps d'arrêt, sans phrases, sans tristesse, dirait-on, si l'on ne jugeait que cette apparence. La peine était réelle, chez tous, mais comme sous-jacente. Elle n'enlevait pas son goût à la cigarette matinale, à un coup de vin bu en hâte. Les blessés regardaient, l’œil voilé. On leur disait : « Mal ? » Les plus atteints approuvaient du menton. « T'en fais pas. » Les hommes de l'autre guerre devaient dire les mêmes mots, qui ont plus de poids et plus de chaleur dans nos bouches que leur sens ne le fait croire.
A la hauteur du 3e bataillon, un layon part vers le nord-est, nous reliant, sous bois, au 9e marocains. Un arbre arraché en barrait l'entrée. Un tirailleur, était assis sur le tronc, soutenant sa main droite dont l'épais, pansement était déjà ensanglanté. Il avait une étroite figure blanche cernée de barbe noire. Il gémissait, appelant sa mère ; « Ehi... Ma ! Ehi... Ma ! » A côté de lui, debout, un gaillard râblé tentait de le réconforter. Lui aussi était blessé à l'avant-bras. Marocain, mais à mille lieues de l'autre, qui' était un Arabe de Fès. - Tu devrais l'emmener vite au poste de secours. Ce n'est plus loin. Un quart d'heure. - Je lui ai dit. Il veut rester assis, parce qu'il dit qu'il a trop mal. - Mais plus vite .il sera là-bas, plus vite on l'évacuera. Je lui ai dit. Il a ses doigts arrachés. Il était cordonnier avant. Al-ors, tu comprends... Et Toi ? Moi, rien du tout. Dans le bras, juste la viande traversée. Je connais déjà. Il se rapproche de moi, l'oeil railleur, et à voix plus basse ajoute : Tu comprends, lui, c'est un homme de la ville. Un Fazi. Moi, je suis un Chleuh, de la montagne. Je sentais tout l'orgueil de ce parallèle. - De quel bled ? - Bou-Gafer, près Djbel-Sagho. Tu connais ? - Je pense bien ! Alors, tu as fait le baroud contre les Français ? - Quatre fois la colonne, la dernière en 1933. Après on s'est soumis. J'ai fait Moghazani au bureau de Zagora, et après la colonne de 1934, à l'Assif-Melloul. Blessé deux fois. Alors tu comprends, je m'en fous. Il disait : « Je m'en fo ! » avec un large rire, découvrant des dents grises. Et ici ? - Pas la même chose. A cause des canons.. Chez nous, les Français n'en avaient pas tant. Ici, tu te mets là, l'obus arrive. Tu te mets à côté, il te trouve. Alors, tu attends, qu'est-ce que tu veux faire ? Il prit mes cigarettes, en alluma une qu'il mit dans la bouche du Fazi, puis le souleva et l'entraina. - Viens, je te dis, c'est bientôt fini.
Ils s'en allèrent à petits pas.
J'étais content d'avoir donné cinq minutes aux deux Marocains. J'ai gardé de mon service, puis de mes séjours au Maroc, une vive amitié pour cette race berbère qui a si vaillamment défendu sa terre jusqu'à ce qu'elle ait compris le choix de Dieu, et qui, ralliée, ne nous a pas marchandé son sang. La présence, ici, de Chleuhs, adversaires récents, n'était plus pour m'étonner. J'en avais vu cent exemples. Et, à y bien penser, c'était pourtant là un autre miracle français. Faire des soldats indigènes c'est à la portée de n'importe quel colonisateur. Mais chez ces Marocains, comme chez les Algériens et aussi plus obscurément chez les noirs, il ne s'agissait pas simplement de mercenaires dont on utilise les aptitudes à la guerre. Il y avait chez eux - je ne crois pas forcer les mots - une adhésion véritable à la cause de la France. Ils ne se battaient pas pour la défense d'un foyer, car ils n'imaginaient pas - contrairement à ce que dit le lyrisme officiel - que leur sort dépendît du destin de la France. C'est là une notion accessible à des élites seulement. Pour la masse la bataille était entre les Français, amis, et d'autres blancs inconnus.
Il était tout naturel qu'on fût du parti des amis; et, comme on est brave, on faisait de son mieux pour vaincre. Non pas qu'on aimât la guerre - encore une légende, - mais il n'y avait pas à choisir, puisqu'elle était déclarée. Le coeur trouvait son contentement dans ce service. Chacun de ces soldats d'outremer avait, dans sa vie, un Français, chef civil ou militaire, patron, auquel il était attaché avec Une manière de tendresse rude. Il se battait avec lui, pour lui, qu'il fût présent dans le bataillon, partageant les mêmes souffrances, ou qu'il fût resté de l'autre côté de l'eau, à son poste. Ce sentiment suffisait à donner racine au dévouement, à la soumission. Le rang, sa chaleur; faisaient le reste ; et si la discipline restait intelligente, le commandement nuancé, et le courage visible chez les chefs, on avait là une troupe magnifique. Ce qui fut le cas dans notre division, on le verra par la suite.
Ces réflexions que je faisais, en trottant pour rattraper mon retard, me donnaient uné grande paix qui me mettait à l'unisson de ce matin radieux. Certes, il y avait les blessés et les morts ; mais courir le même risque vous gardait de la tristesse, et même de cette ombre légère qui recouvre l'instant au passage de la mort.
Le bois était plein de coucous, qui se relayaient pour lancer leur appel, de l'aube à la nuit. On disait même que certains n'étaient pas des oiseaux, mais que le cri était un signe de ralliement pour les patrouilles ennemies. Cela n'a pas été vérifié. Avec ces sacrés Allemands, fertiles en inventions pour nous faire tourner en bourriques, tout était possible.
Au bataillon, remue-ménage. On déplaçait des abris. Les hommes, devant le chiffre des blessés et des morts, atteints en plein repos, commençaient à comprendre que la pelle et la pioche vous donnent brevet de longue vie.
En bordure du bois carré, l'observateur ouvrait des yeux patients qui découpaient l'horizon limité, en parcelles fouillées. De l'ennemi on ne voyait pas grand'chose. Au delà de cette prairie il y avait une corne de bois, puis l'amorce d'un piton, avec des traces claires de travaux récents. Et plus loin encore une ferme à demi détruite. Rien ne bougeait. Le vent d'ouest caressait les campanules. L'un de nous dut faire un geste trop brusque, qui décela sa présence. Une rafale de mitrailleuse hacha des branchettes sur nos têtes. Sur notre droite une de nos pièces donna la riposte. Et de nouveau le merveilleux silence sur la campagne trompeuse.
« Ils travaillent derrière ce monticule. On les entend la nuit. Ils. doivent mettre du barbelé pour barrer la trouée. »
L'observateur reprit sa veille, les yeux collés aux jumelles, et dans une attention si absolue qu'on croyait voir la chair du visage aspirée, sucée par l'effort des yeux.
Le chef de bataillon, en me remettant son papier, commenta la situation :
Trop de pertes pour rien. C'est du grignotage. Si nous ne devons pas avancer pour nettoyer le bois, il faut s'installer en profondeur.
Sans ça, chaque nuit verra fondre un peu plus les effectifs.
Les camarades, au passage, interrogeaient : Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne va pas aller jusqu'à la sortie du bois ?... On ne fera rien de bon dans cette forêt. Les-Allemands s'y baladent, dès qu'il fait nuit, comme chez eux.
(A suivre.)
7 jours : grand hebdomadaire d'actualités 19410518
7 jours : grand hebdomadaire d'actualités 19410511
Page 1 sur 5